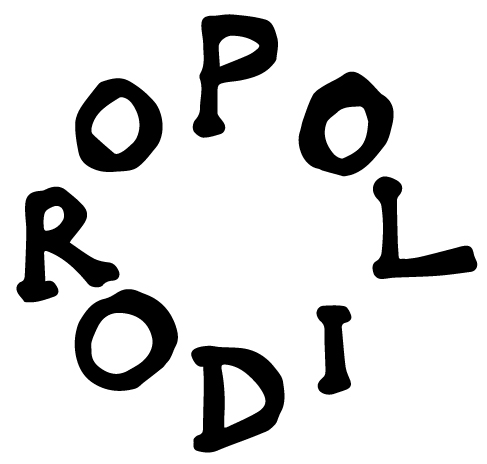HABITER LES ORAGES
«La maison, dans la vie de l’homme, évince des contingences, elle multiplie ses conseils de continuité. Sans elle, l’homme serait un être dispersé. Elle maintient l’homme à travers les orages du ciel et les orages de la vie.¹»
C’est presque un sentiment de terreur qui sourd des deux dernières séries de travaux de Julie Polidoro, d’autant plus insidieux que leur raffinement chromatique et l’éclat précieux de certaines teintes (voir le rose floral du ciel de Mongolian Storm, le dégradé bleu du plafond de Parking-people, ou le turquoise de la chemise d’un travailleur endormi dans The Sleepers) exercent une attraction sensuelle, voire jubilatoire, sur l’œil. Si les motifs divergent – les « Invisibles » d’une part, des êtres condamnés à l’exil et parqués par les autorités des pays qu’ils tentent de rejoindre, les tempêtes de sable de l’autre – ces deux corpus s’articulent tragiquement. Ils sont parcourus par la même urgence. Car malgré la « simplicité » de leur support (toiles sans châssis pendues sur un mur), ces œuvres actualisent, loin de toute dramatisation, la Catastrophe, dérèglement climatique ou déplacement forcé de populations, deux symptômes inextricablement liés d’une crise d’ampleur planétaire. Le décalage temporel induit par les images dont Julie Polidoro part – des photographies collectées sur internet –, installe son geste dans l’incertitude et soumet le regardeur à l’attente, que ce soit celle de migrants incertains de leurs sorts ou celle qui précède les déchaînements de la nature. Julie Polidoro figure moins la catastrophe – elle ne s’inscrit pas dans la tradition romantique du 19 ème et de son goût pour les représentations horrifiques ou sublimes de tempêtes, avalanches ou naufrages d’un Théodore Géricault, Joseph Vernet ou William Turner – qu’elle ne la spatialise et en analyse les étendues. Comme pour résister à sa démesure, elle cherche à mesurer l’occupation (envahissement par le sable) ou la négation de l’espace (destin d’individus sans maison ni patrie) qu’elle entraîne.
Il y a de la menace dans la frontalité de ses Dust Storms, dans ces amoncellements de matière indéterminée, qui évoquent autant des nuées, des troupeaux de bêtes que des reliefs rocheux, et qui semblent avancer droit vers nous, blocs de violence au bord de l’explosion. Comme il y a du vertige dans les alignements de corps anonymes qui peuplent ses Invisibles, des hommes et des femmes qui font régulièrement la une des médias occidentaux et dont pourtant rien n’est connu sinon qu’ils et elles vivent en sursis, dans une précarité totale.
Dans les deux cas, Julie Polidoro met en œuvre une oppressante saturation du regard.
D’un côté, des nuages de sable dévorent l’espace même si l’étagement des plans conserve le souvenir d’une structure paysagère. S’y distinguent de fragiles habitats, les tracés d’une route, des champs et peut-être des poteaux électriques. Mais le paysage est oblitéré et remplacé par des perturbations atmosphériques aux couleurs monstrueuses dans leurs flamboiements sophistiqués. De l’autre, un patchwork de tapis, serviettes et sacs de couchage, quadrille les lieux et délimite les mètres carrés alloués à chacun (Sleepers) ou s’étend, comme à l’infini, jusqu’à se dissoudre dans une multitude de formes abstraites (Those Who Wait), cartographie dérisoire des territoires inexistants d’une humanité de seconde zone. Dans ces vues latérales ou en plongée, sans horizon, la suggestion d’une expansion, hors du cadre, des matelas de fortune ou des compartiments-cellules (Sleep-box), accentue l’entassement qui prévaut dans ces locaux que Julie Polidoro arpente en les peignant. Elle insiste ainsi sur la difficulté qu’il y a, dans ces circonstances, à individualiser les exilés, entravés dans leur mouvements et agrégés à une masse inconnue.
Si elle introduit la figure humaine, fait rare dans son travail, c’est prioritairement pour désigner les conditions de vie de corps-archipels limités à des activités basiques – essentiellement dormir, boire et manger – dans une promiscuité permanente. Gaston Bachelard ne disait-il pas que « la maison abrite la rêverie, la maison protège le rêveur, la maison nous permet de rêver en paix » ² ? Repli intérieur interdit à ceux que Julie Polidoro dépeint. De leurs songes ou cauchemars nous ignorons tout alors qu’ils restent muets, sans nationalité et sans chair, engoncés dans l’impersonnalité de l’espace auquel ils sont réduits.
Cet état que Polidoro parvient à saisir relève avant tout du blocage temporel, de l’immobilisation illimitée, de la stase. C’est bien du temps qu’elle rend palpable en déployant ces espaces, en s’affrontant à de l’irreprésentable : le statut d’individus « en transit » qui n’habitent pas un lieu mais l’attente. Ses toiles dont la matérialité est réaffirmée par le relief de leurs plis donnent de la tangibilité à cet enfermement sans fin, à cette absence de liberté qui prive de la possibilité d’alterner entre action et solitude, « d’avoir du temps à soi » dirait Claire Marin³ .
Pliures, intensité variable et superposition soignée des couleurs – marques plastiques du processus créatif de Julie Polidoro et du temps qu’il implique – pointent vers celui dont ne peuvent disposer les migrants. Rappel subtil des inégalités qui divisent la société entre ceux qui y ont leur place et les autres. « Il propio lugo », ce sont précisément les mots que Polidoro choisit, parmi d’autres (qui résonnent tout aussi douloureusement : « uscire », « cambiare posto », « tempo intimo », « altrove » etc..), d’écrire à la surface de Migrant Workers. Inscriptions-incisions qui, dispersées dans la forêt orangée où deux hommes dorment près de leurs vélos, viennent trancher dans le lieu représenté. Car Julie Polidoro ne manque jamais de signaler la nature de ce réel : elle peint des images d’images. La discrète présence d’un téléphone au premier plan de The Invisibles, entre les mains d’un homme allongé dont les jambes ont été coupées par le cadrage, souligne la perpétuelle circulation des images que Julie Polidoro interroge dans ce nouveau travail. Il n’est pas anodin qu’un téléphone, premier support, avec l’ordinateur, de ces dernières apparaisse ici alors que Polidoro s’empare de la surconsommation actuelle des représentations de la misère migratoire, devenues des clichés, y compris chez certains artistes. Elle passe au filtre de ses pigments le substrat médiatique à l’origine de l’existence paradoxale de migrants surexposés mais invisibles.
Avec The Invisibles, elle extrait du flux abêtissant et insipide de photographies et vidéos inondant nos écrans une réalité oubliée dès que postée sur les réseaux sociaux, publiée dans les journaux ou avalée par le reportage suivant à la télévision. Elle nous réveille à notre habitude de faire défiler et effacer d’un « clic » des images, quelle que soit leur nature – photographies d’actualité, vêtements sur des sites marchands, conquêtes d’un soir sur des applications de rencontre ou publicités intempestives. Geste de suppression dont elle reporte la violence latente sur la toile lorsqu’elle la lacère systématiquement (Parking-people).
Abîmant, trouant son médium, elle l’ouvre à l’obscénité de son sujet tout en niant la planéité de nos appareils informatiques, la distance rassurante que leurs parois vitrées interposent entre nous et le réel. Elle épingle donc le regard, en ajoutant, dans les coins, ou le long du bord de ses œuvres les symboles des actions nécessaires à la navigation sur internet ou les données fournies lors de l’ouverture d’une fenêtre ou d’un fichier. Elle redonne ainsi une visibilité à des images disparues sitôt que partagées mais non sans les miner au préalable. Les mettant à nu, elle sape l’artificialité de leur point de vue fondé sur la perspective mono-focale et la fragmentation de leur cadrage. « Remise à plat » visuelle qui rejoint les nombreuses opérations plastiques à travers lesquelles Julie Polidoro tente de lire le monde autrement. Elle ne cesse de détourner les outils cartographiques pour décentrer le regard, proposer de poétiques relevés de territoires, et désorganiser le planisphère et ses tracés éminemment politiques. Cette fois, elle nous invite sur les lieux du désastre – cieux, gymnases aménagés ou casiers préfabriqués – et nous rappelle que nous serons de plus en plus nombreux à habiter les orages.
¹Gaston Bachelard, La poétique de l’espace [1957], PUF, 1961, p.34-35.
² Ibid., p.34.
³ Claire Marin, Être à sa place. Habiter sa vie, habiter son corps, Éditions de l’Observatoire, 2022.
Alix Agret est chercheure et historienne de l’art. Elle est actuellement chargée de recherches au musée Matisse de Nice.